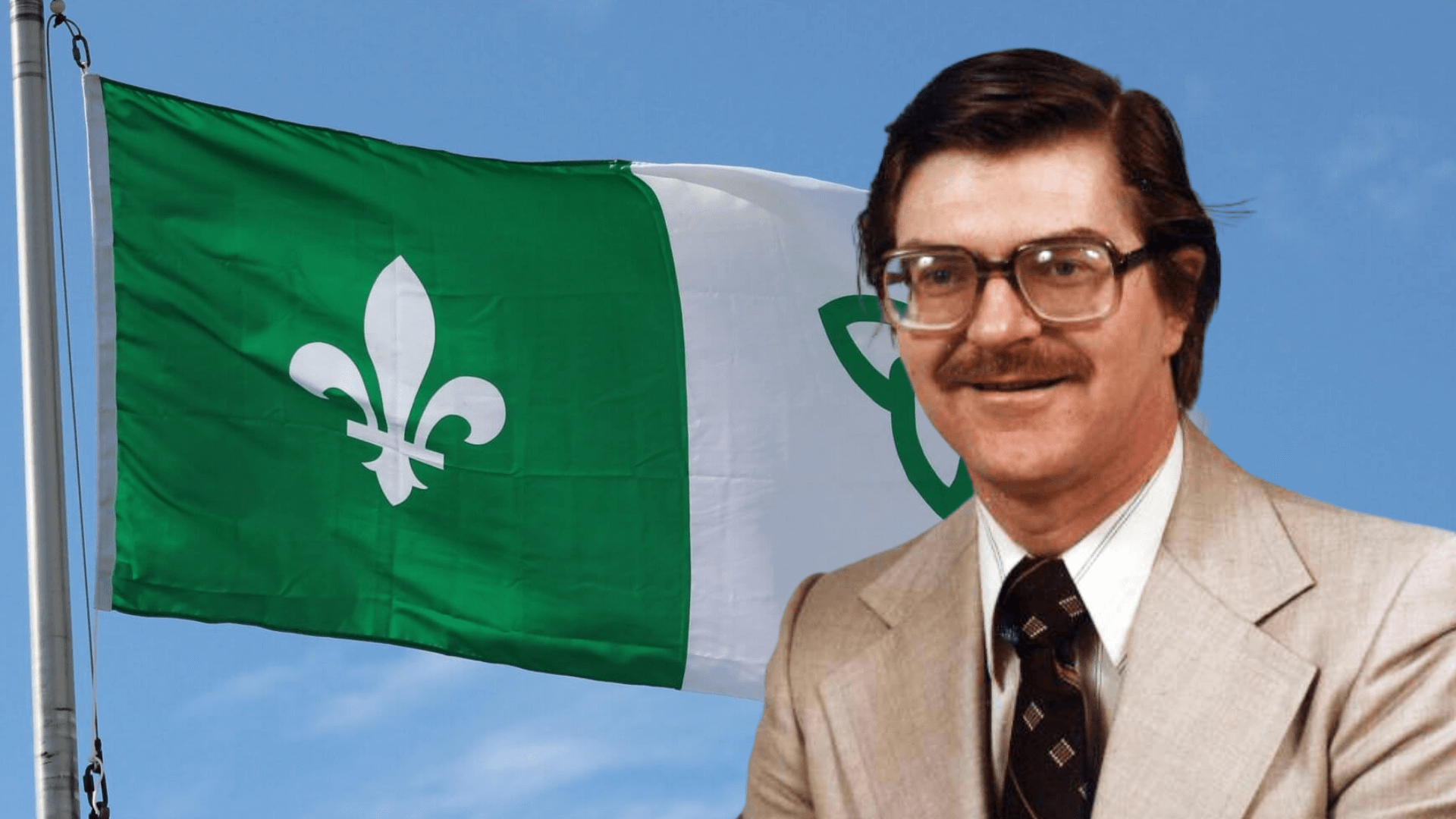
Drapeau franco-ontarien : « Gaétan Gervais a joué un rôle refondateur »
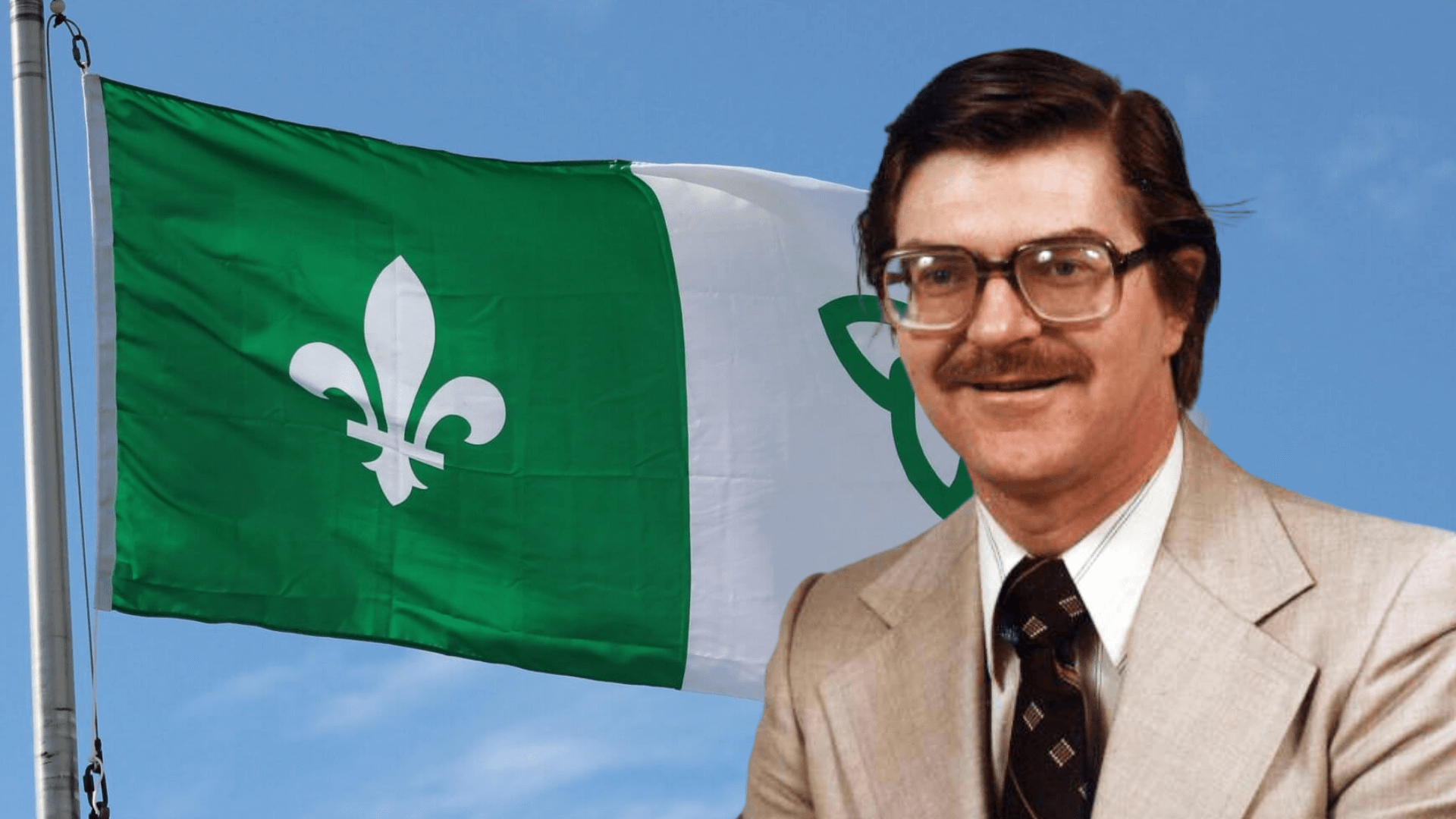
[ENTREVUE EXPRESS]
QUI :
Michel Bock est professeur titulaire au département d’histoire de l’Université d’Ottawa, professeur associé à l’Université de Sudbury et directeur du Centre de recherche sur les francophonies canadiennes.
CONTEXTE :
Le drapeau franco-ontarien a été hissé pour la première fois il y a 50 ans, le 25 septembre 1975, à l’Université de Sudbury.
ENJEU :
Alors que se prépare le 50e anniversaire partout à travers la province, l’historien remet en perspective l’influence de Gaétan Gervais, à l’origine du drapeau.
Le drapeau vert et blanc est né dans un contexte très particulier…
On traversait en effet un moment de remise en question sur le plan identitaire assez substantiel, un moment post-canadien-français où la Révolution tranquille des années 1960 était encore fraîche dans les mémoires. Les rapports entre les différentes composantes de ce que l’on appelait le Canada français étaient en pleine redéfinition.
Dans certains milieux franco-ontariens, on vivait cela sur le mode presque du traumatisme. Au Québec, certains nationalistes québécois estimaient que les minorités n’avaient aucune chance de survie, alors qu’à l’inverse, dans les milieux franco-ontariens, on accusait le Québec de les avoir abandonnés.
Quel rôle Gaétan Gervais a-t-il joué dans la mobilisation autour du projet?
Il a joué un rôle névralgique de par sa position de chargé de cours (à l’Université Laurentienne). Formé par des jésuites de Sudbury, au Collège Sacré-Cœur, il connaissait les grands penseurs du nationalisme canadien-français. Les jésuites étaient très actifs dans la mobilisation politique et linguistique de la population francophone du Nord de l’Ontario. Gaétan est donc tombé dedans très jeune et a fédéré autour de lui un certain nombre d’étudiants, comme Michel Dupuis.
Il n’était pas encore l’historien de l’Ontario français qu’il allait devenir à partir du début des années 1980, mais il voyait bien que pour consolider l’identité franco-ontarienne, il fallait des symboles mais aussi que les francophones connaissent leur propre expérience historique. C’est pourquoi il a été parmi les premiers à donner des cours d’histoire sur l’Ontario français. Il a joué un rôle fondateur, et même refondateur au niveau symbolique, politique et culturel.
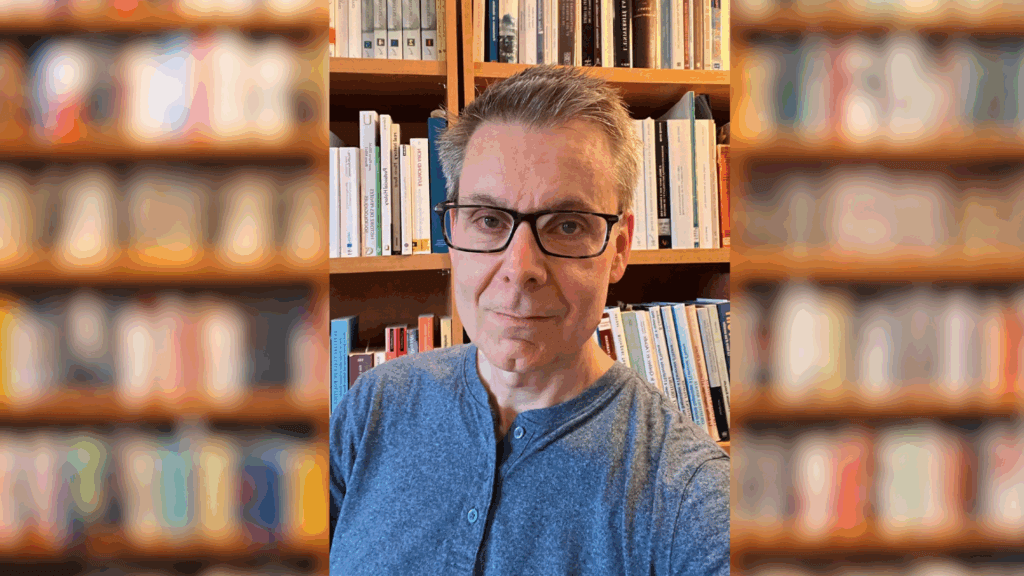
Quelle était son intention en créant ce drapeau?
C’était d’essayer de reconsolider les assises identitaires et historiques de l’Ontario français sur des bases en partie anciennes et nouvelles. C’est pour répondre à cette nouvelle demande de sens – que l’on exprimait de plus en plus fortement dans les années 1970 – que les concepteurs du drapeau ont posé leur geste.
Pourtant, les Franco-Ontariens ne se sont pas immédiatement approprié ce symbole. Il a même fallu attendre plusieurs années avant qu’il fasse l’unanimité…
L’Ontario français n’a pas d’existence juridique ou politique formelle. Il n’y avait pas un parlement pour décréter que ce drapeau serait le symbole par excellence de la communauté. Ça s’est fait graduellement, d’autant que c’est parti du Nord où les francophones sont très dispersés. Les idées ne circulent pas de la même façon. Il a fallu attendre les années 1990 pour qu’on en vienne à le considérer comme le symbole presque universel de la communauté.
Les crises ont-elles contribué à cet ancrage?
Oui, on renoue à partir des années 1970 avec une forme de militantisme qui s’était éteint avec la crise du Règlement 17 dans les années 1910 et 1920. Le drapeau est arboré dans les crises scolaires comme celle de Penetanguishene, puis s’impose 20 ans plus tard dans la crise Montfort, de façon massive et sans discussion (…) dans des moments médiatisés qui lui donnent une grande visibilité. On était clairement en territoire franco-ontarien, avec toutes les caméras braquées dessus.
Ça n’est donc pas une coïncidence quand, en 2001, le gouvernement ontarien le reconnait comme symbole de la communauté. (…) Ça a été compliqué dans d’autres circonstances avec de la résistance de certaines municipalités qui ont refusé de le reconnaitre. Ça a été compliqué à Sudbury, North Bay ou plus récemment à Greenstone. Dans certains milieux anglophones, on se demandait pourquoi donner une telle reconnaissance à un groupe ethnique plutôt qu’un autre. On l’évaluait à l’aune du multiculturalisme canadien.
Aujourd’hui, ce drapeau détient une forte valeur politique et identitaire. Est-ce plus facile de revendiquer des droits avec un tel « outil »?
Oui et non. Le danger c’est de réduire la reconnaissance de la communauté à son drapeau. On le hisse le moment opportun, puis on le descend, on l’oublie et on a l’impression d’avoir agi. Il est donc très utile, car il permet à la communauté de s’afficher publiquement, de se rallier à un symbole. Mais il peut aussi servir d’alibi commode.
On peut confondre l’être et le paraître et, institutionnellement, voir les choses avancer moins vite qu’on ne le voudrait. On le voit avec l’Université de Sudbury qui a ouvert il y a quelques semaines après des années de revendications. C’est bien beau un drapeau, mais il faut que sa reconnaissance s’accompagne de la nécessité pour la communauté de s’autonomiser dans un plus grand nombre de domaines.
