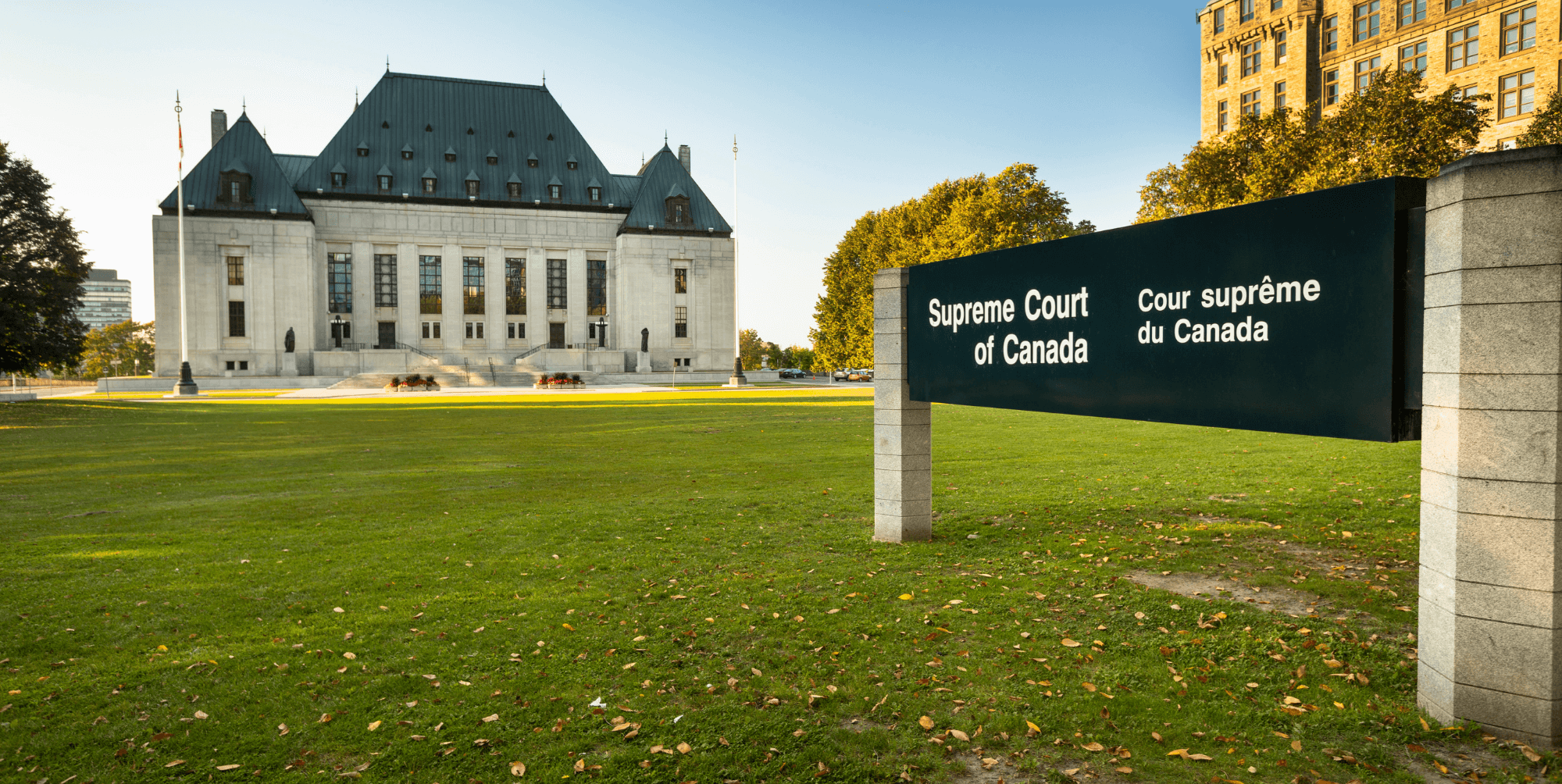
Loi 21 en CSC : le droit de gestion par et pour les francophones en danger, plaident les écoles publiques
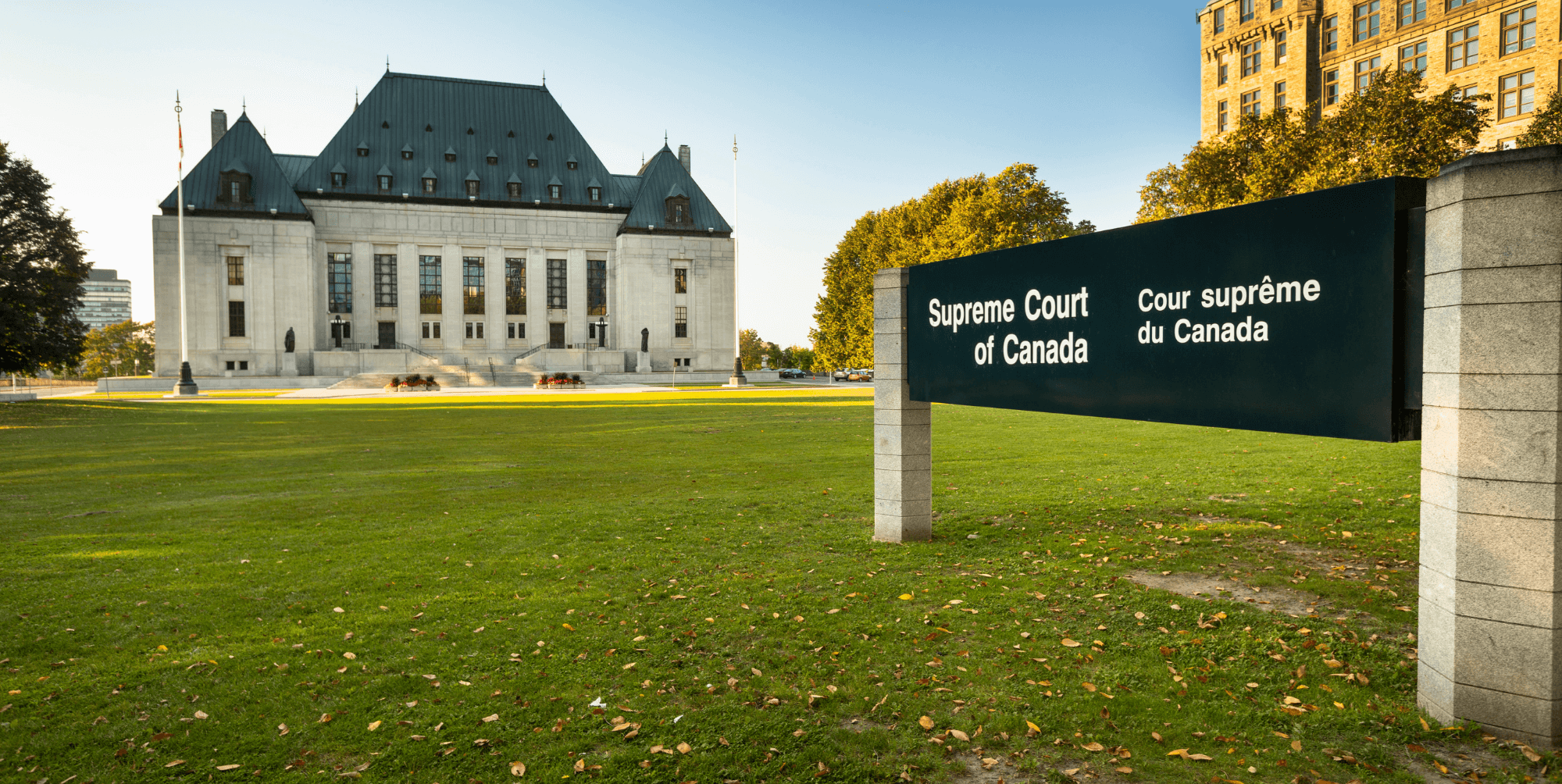
OTTAWA — C’est le fondement même des écoles franco-ontariennes qui est en jeu en Cour suprême dans le cadre du dossier de la Loi 21 du Québec, plaident les conseils scolaires publics francophones. Le droit de gestion du modèle scolaire par et pour les Franco-Ontariens et leur modèle d’enseignement pourraient être remis en cause, estiment-ils.
C’est la position que les avocats de l’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO) avancent dans un mémoire présenté à la plus haute cour du pays, fin septembre, qui entendra la cause de la contestation de la loi 21, aussi appelée Loi sur la laïcité de l’État du Québec.
L’ACÉPO, qui représente près de 145 écoles des quatre conseils scolaires publics francophones de l’Ontario et le Consortium Centre Jules-Léger, plaide que si la Cour suprême maintient une partie de la décision rendue par la Cour d’appel du Québec, cela « modifierait donc de façon fondamentale l’environnement juridique applicable aux écoles francophones » en dehors du Québec, craignent-ils.
L’association ne prend pas position sur la Loi 21, mais s’attaque plutôt à un argument de la Cour d’appel du Québec qui avait statué dans un jugement en février 2024 que la Loi 21 s’applique aux écoles anglophones du Québec.
La Loi sur la laïcité de l’État interdit le port de signes religieux pour les employés de l’État québécois en position d’autorité comme les juges, les policiers, les procureurs de la Couronne, les directeurs d’école et les enseignants. (À noter que les conseils scolaires publics francophones se définissent eux-mêmes comme laïcs.)
La Commission scolaire English Montreal (CSEM) conteste l’imposition de la Loi 21 dans ses écoles, jugeant que cela contrevient à l’article 23 de la Charte qui protège le droit de gestion et garantit les droits à l’instruction dans la langue de la minorité. Les anglophones au Québec et les francophones hors Québec bénéficient des mêmes protections en vertu de l’article 23.
Des craintes pour la gestion des écoles franco-ontariennes
À l’heure actuelle, l’Ontario définit les grandes lignes du curriculum et du cadre à suivre, mais ce sont les écoles francophones qui déterminent son application dans un contexte culturel francophone. Par exemple, l’embauche de professeurs, le matériel pédagogique et l’enseignement en classe relèvent des conseils francophones.
Or, l’ACÉPO craint que si une part de l’approche de la Cour d’appel du Québec sur la Loi 21 est maintenue, l’Ontario pourrait par exemple imposer le même programme aux élèves anglophones et francophones.
« La province serait libre de fixer à sa guise toutes les modalités de la prestation de l’instruction en cause, autre que le code linguistique employé, dont le déploiement n’exigerait aucunement la mise en place d’un système de gestion autonome pour la minorité », prévient l’ACÉPO dans son mémoire.
« Un tel virage aurait notamment pour effet d’autoriser les provinces à imposer un programme scolaire parfaitement uniforme à toutes les écoles relevant de leur compétence, pourvu que la langue de la minorité soit employée comme moyen de communication, et ce, contrairement aux enseignements d’une jurisprudence constante », s’inquiètent les quatre conseils scolaires francophones de l’Ontario.
Après l’avoir demandé, l’ACÉPO a obtenu le statut d’intervenant dans la cause et pourra présenter ses arguments lors des audiences prévues par le plus haut tribunal au pays, dont la date n’a pas encore été déterminée par la Cour suprême.
La langue et la culture au cœur du débat
Les commissions scolaires de la minorité anglophone ont affirmé devant la Cour d’appel du Québec que la diversité culturelle, ethnique et religieuse était une valeur fondamentale de la culture de leurs communautés et que cela faisait donc partie de leur droit de gestion. Cette argumentation a été rejetée par le tribunal québécois qui avait plutôt statué qu’il doit y avoir un lien « étroit, voire fusionnel » entre la culture et la langue pour être protégé par l’article 23.

Dans son mémoire de plus d’une dizaine de pages, l’ACÉPO soutient que la langue et la culture sont distinctes, mais inséparables et qu’elles doivent être protégées séparément par le droit à l’éducation en milieu minoritaire. Par exemple, la transmission de la langue, le sentiment d’appartenance à la communauté sont des éléments cités comme faisant partie du rôle des écoles francophones et qui doivent être protégées, défendent les écoles publiques.
« Selon l’ACÉPO, la jurisprudence antérieure milite en faveur d’une approche qui reconnaît à la minorité le droit de définir, par l’entremise de ses institutions représentatives, les contenus qui caractérisent sa culture et son identité culturelle », peut-on lire comme argumentation.
L’ACÉPO prévient que c’est la raison d’être même du système scolaire francophone en milieu minoritaire qui pourrait être affaibli, avertit-il à l’intention des juges du plus haut tribunal canadien.
« L’adoption de ce critère par cette Cour aurait donc pour effet de modifier de façon dramatique le cadre juridique sur lequel reposent les politiques des provinces où se trouve une très grande majorité des francophones en situation minoritaire, soit l’Ontario et le Nouveau-Brunswick. »
Les 145 écoles publiques de langue française ne sont pas les seules à avancer de tels arguments en Cour suprême. Le Commissariat aux langues officielles et la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), qui ont eux aussi obtenu le statut d’intervenant, avancent une argumentation similaire.
La SANB écrit dans son mémoire d’intervention que si elle est maintenue, la décision de la Cour d’appel du Québec concernant l’article 23, « mettrait en péril le projet de société dont s’est doté le Nouveau-Brunswick d’assurer que les écoles de la communauté acadienne et francophone soient de véritables foyers de transmission culturelle ».


